Bien Dire est un magazine dont l’objectif est d’aider à apprendre le français, à « Bien Dire », dont le slogan est « le français par la culture ». Le numéro de la fin de l’année se focalise sur le Maroc, avec toute une série d’articles pour faire découvrir le pays.
L’objectif étant avant tout l’apprentissage / perfectionnement en français, les articles ne sont pas d’un niveau universitaire.
J’ai été agréablement surprise, pourtant, par la plupart d’entre eux, notamment un sur les relations entre la France et le Maroc qui ne fait pas l’impasse sur les sujets difficiles (le refroidissement actuel des relations entre les deux pays) et présente le Protectorat comme ce qu'il était : une colonie.
Par contre, l’un d’entre eux m’a beaucoup gênée, parce qu’il est rempli d’imprécisions et d’à peu près qui le rendent faux, c’est celui sur les langues du Maroc. Par respect des droits d’auteurs, je ne vous mettrais que quelques extraits, « citations visant à soutenir le propos »…
Arabe Littéraire et Arabe standard (fusha)
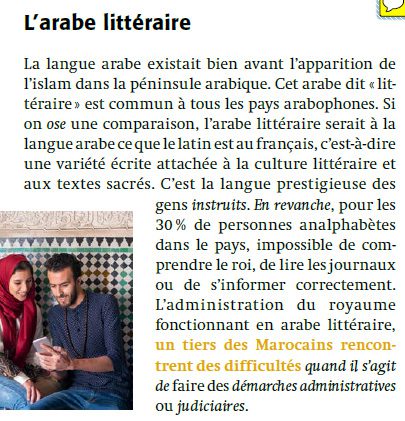
Oui mais non.
Il y a deux « arabes », l’arabe littéraire, qui est aussi celui du Coran, et l’arabe dit « standard », fusha en arabe, MSA en anglais (pour Modern Standard Arabic). Les deux arabes sont communs à tous les pays arabophones et à beaucoup de Musulmans qui ont choisit d’apprendre l’arabe.
L’arabe littéraire est beaucoup plus complexe que le standard. Il serait effectivement l’équivalent du latin mais par rapport à l’italien moderne plutôt qu’au français moderne utilisé partout dans la francophonie.
A cette différence près qu’il est utilisé au quotidien par les juristes, les religieux et assez régulièrement par les gens instruits. On disait, par exemple, que le roi Hassan II avait une maîtrise parfaite de cet arabe littéraire, « haut de gamme ».
Néanmoins, au quotidien, dans les journaux, les formulaires administratifs, à la télévision, c’est l’arabe standard qui est utilisé. Il est plus simple, un certain nombre de règles grammaticales sont un peu oubliées. Pour comparer avec une autre zone linguistique, c’est le même style de différence qu’entre le corpus classique des idéogrammes chinois (50.000 caractères) et le système simplifié (5.000 caractères).
La langue « des » Amazighs

Mais c’est surtout ce paragraphe qui m’a gênée et finalement envoyée sur mon clavier.
Et sur un sujet brûlant …
Commençons par le titre : la langue « amazighe » s’appelle tamazight et c’est la langue des Imazighen (pluriel d’Amazigh) qu’on a l’habitude d’appeler Berbères en français.
Et si on veut utiliser amazigh comme adjectif, on n’ajoute pas de e : le féminin se forme avec un t(a) initial et un t final (oui, comme tamazight, incroyable non ?)
Étymologiquement, c’est le mot « Berbère » qui est rattaché aux « Barbares » grecs (c’est à dire à tous ceux qui ne parlaient pas grecs).
Amazigh, lui, veut dire « Homme Libre ».
Deuxièmement, il n’y a pas au Maroc « une langue amazigh » mais trois : le tarifit (dans le nord, la langue des Rifains), le tamazight, la langue des tribus de l’Atlas Central et le tachelhit, la langue des chleus, effectivement dans le Souss. Le tamazight est le mot utilisé pour désigner « le berbère » sans spécifier un dialecte.
Troisièmement, c’est un détail, mais je ne comprends pas d’où sortent les pourcentages. Il y a beaucoup plus de Marocains d’origine berbère (entre 70 et 80% selon les estimations) et beaucoup moins de berbérophones (au mieux 25%).
Les différents berbères s’écrivent
Là, on n’est plus du tout dans le détail. Le tifinagh marocain, celui de l’IRCAM, est utilisé sur les panneaux, dans un certain nombre de documents administratifs. Il est aussi écrit dans tous les livres scolaires d’apprentissage du tamazight, obligatoire à l’école publique marocaine (mais pas à l’AEFE où enseigne l’auteur de l’article).
De nombreux auteurs amazigh écrivent dans leur langue, que ce soit en tifinagh ou, plus simplement, dans une transcription en alphabet latin avec quelques caractères rajoutés. Cette langue est vivante, écrite et sert à communiquer.
(Si vous voulez voir une transcription en caractères latins, vous pouvez par exemple chercher les paroles de Vava Inouva d’Idir sur Google. C’est du kabyle, mais c’est pareil).
Enfin, avant l’arrivée des Européens au Maroc, le tamazight s’écrivait. On trouve des textes littéraires, des récits, où il est utilisé, mais transcrit avec des caractères arabes. Les tous premiers dictionnaires et grammaires de berbère, du XIX° siècle, l’écrivent en arabe.
Comme le démontre si bien Linguisticae, on peut – plus ou moins facilement – écrire n’importe quelle langue dans n’importe quel alphabet.
Dans la pratique, les Marocains écrivent beaucoup en darija
Clairement, dire que dans la pratique, les Marocains écrivent soit en arabe littéraire, soit en français est une grosse simplification.
L’arabisation s’est faite, effectivement, au détriment de la darija, qui est censée ne pas s’écrire, en tout cas en abjad arabe. Il y a là une posture politique avant tout, qui se heurte à la réalité : il suffit de se souvenir du « mini scandale » quand un livre d’école avait inclus le mot « baghrir » (ou msemem, je ne sais plus), typiquement marocain, mais qui n’appartient pas à l’arabe standard. Mot arabe que chacun prononce quotidiennement.
Un système de transcription s’est développé, basé sur les caractères latins auxquels on ajoute des chiffres pour symboliser les sons qui n’existent pas en français. Et cette transcription s’utilise au quotidien, dans les sms, sur Facebook…
Les Marocains écrivent beaucoup moins en français qu’en arabe ou qu’en darija
Maitriser suffisamment le français pour l’écrire couramment et spontanément est le fait d’une élite restreinte, à peine plus large que celle des Marocains ayant étudié dans les écoles étrangères (car il y a, malgré tout, un monde en dehors de l’OSUI-AEFE).
Par contre, dans la classe moyenne, celle des employés, des commerçants, des patrons de PME, écrire en arabe est nettement plus courant qu’écrire en français. Spontanément, deux Marocains qui parlent arabe ne vont pas communiquer en français, encore moins par écrit, à moins d’y être totalement obligés…
Ou alors ils pratiquent un mélange étrange, une sorte de créolisation qui fait hurler les puristes, mais qui fonctionne

La définition du « bled », un détail de vocabulaire

Il s’agit de la définition française, reprise dans de nombreux dictionnaires.
Normal, puisque « bled » est un mot … français. Le mot marocain est « bilad » qui s’écrit بلد et qui veut tout simplement dire « pays » (c’est le mot utilisé dans la fiche Wikipedia, comme vous pouvez le voir en affichant la version arabe de la page française). Le « i » est prononcé de façon assez peu marquée, d’où la transformation par les colons français.
En Afrique du Nord, et donc au Maroc, c’est un mot qui a de multiples sens, comme en français. Quand un Marocain parle du Maroc, c’est « son pays » au sens large, pas seulement sa « région » d’origine.
 Il y a eu pendant longtemps (2003-2015) une campagne pour faciliter le tourisme interne qui s’intitulait « Kounouz Biladi » (Les trésors du pays), dont le logo utilisait l’alphabet latin pour ces mots arabes !
Il y a eu pendant longtemps (2003-2015) une campagne pour faciliter le tourisme interne qui s’intitulait « Kounouz Biladi » (Les trésors du pays), dont le logo utilisait l’alphabet latin pour ces mots arabes !
Bien sûr, « son bled » c’est aussi sa région. Comme en France, on disait « mon pays » pour désigner quelqu’un originaire du même endroit que vous.
Retourner au bled peut simplement vouloir dire rentrer dans sa famille (par exemple pour l’Aïd), sauf si vous allez dans une grande ville. Cela peut aussi vouloir dire régresser, quand on revient s’établir dans son village après avoir échoué en ville.
Le « blédard » est un campagnard, quelqu’un d’un peu rustre. C’est aussi pour les MRE, quelqu’un qui vit encore au pays. Les filles ne veulent pas épouser un blédard.
Enfin « beldi » est un adjectif utilisé pour qualifier ce qui est naturel, « bio » (ou considéré tel), artisanal, fait maison… cela correspond à la notion de produit du terroir.
Certes, je pinaille…
En tout cas, il y a pas mal d’autres articles dans ce numéro, une interview de Tahar Ben Jelloun, une autre de Leïla Slimani, qui valent le coup.
En savoir plus
- Maroc. La guerre des langues est déclarée
- Quand l'introduction de mots de darija dans les manuels scolaires provoque une levée de boucliers, (Reprise d'un article publié en 2018 sur Le 360 par Karim Boukhari).
 Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !
Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !




