Nous sommes allé hier dans une des plus grandes casbahs du sud du Maroc, pour faire un site internet.
Avec ses 26 mètres de haut, la casbah Aït Abou domine la palmeraie de Skoura. Malgré la chaleur ambiante, on dort merveilleusement bien dans ses chambres, à l’abri des gros murs de pisé.
Il y a dans ces constructions, dans celles des ksars du sud, un savoir-faire certain. La maîtrise d’un matériau pas simple, le mélange de terre, de paille et d’eau doit être correctement dosé pour que la terre ne s’effrite pas, une fois sèche, et bien sûr il dépend de la composition du sol.
La kasbah doit être entretenue très régulièrement, faute de quoi elle se détériore en peu d’années.
Déjà, quand on parle de différence culturelle comme le fait très justement Philippus, il faut prendre cela en compte.
Pour beaucoup de raisons, qui tiennent tant aux matériaux de construction qu’à l’histoire et aux modes de vie, les constructions marocaines, à l’exception des grands monuments et des fortifications, ont la vie courte. Et la plupart de ceux que nous connaissons ont quelques siècles au maximum. C’est plus que 99% des maisons d’Amérique du Nord !
La médina de Fès est une exception, à Rabat il ne reste que la tour Hassan et les ruines du Chellah, à Marrakech la koubba almoravide, Sijilmassa a complètement disparu dans les sables. Bref, le très ancien est quasiment absent du Maroc, et là où on construisait en dur, les aléas politiques et les successions dynastiques faisaient la même œuvre de destruction que le climat plus au sud. Marrakech a été plusieurs fois mise à sac, par exemple.
Le mode de vie très nomade favorisait un ameublement fait essentiellement de tapis, de tentures, de coussins, que cela soit pour le sultan qui se transportait d’une ville à l’autre, ou pour les habitants des ksars, qui déménageaient au fil des saisons entre maisons d’été et maisons d’hiver.
Avez vous déjà passé un peu de temps dans un vrai ksar ? – Par là je veux dire une construction réellement traditionnelle, pas une de ces casbahs restaurées à coup de parpaings habillés de terre cuite ou de faux tadelakt. Les plafonds sont faits de trois couches, troncs de tamaris, roseaux tressés, et terre battue, le tout sur des poutres de palmiers. Ils sont étonnamment souples et élastiques, on a l’impression de marcher sur une couverture tendue, on rebondit un peu à chaque pas. Évidemment, ce genre de construction n’a pas la même dynamique que du ciment.
Il est naturel qu’un mur de terre cuite se fissure, le simple dessèchement de la terre produit des micro-craquelures qui sont sans importance.
Bref, pour résumer, jusqu’au début du XX° siècle, les Marocains ont produit des maisons qui étaient particulièrement bien adaptées à leur environnement, et qui correspondaient à leur mode de vie, y compris aux nécessités de se défendre lors des nombreuses guerres tribales (et les très hautes marches irrégulières des escaliers sont par exemple un moyen de couper l’assaut de l’adversaire).
Avant, ils ont fait appel aux Européens pour construire des fortifications comme celles d’Essaouira, ou ont tout simplement repris celles laissées par les Espagnols et les Portugais dans d’autres villes.
Ce qui se faisait depuis longtemps, comme le tissage et la maroquinerie continue à bien se faire. J’ai rarement entendu quelqu’un se plaindre de son tapissier, par exemple.
Ce qui est nouveau doit s’apprendre. Et à l’aune d’une transmission orale par l’apprentissage, local, entre un mâalem pas toujours lettré et un jeune enfant, cela prend du temps. Du temps pendant lequel les clients vont aussi apprendre à être plus exigeants.
 Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !
Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !



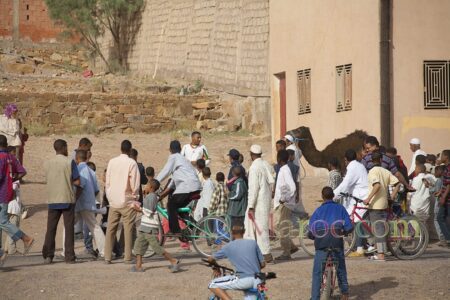

2 commentaires
bonjour, votre article est bien intéressant. j’aimerais quelques précisions quant à ceci « […]habillés de terre cuite ou de faux tadelakt. » pour quelle raison dites vous « faux tadelakt ». Existerait-il un vrai et des faux tadelakt au Sud Maroc ? Quel est le vrai ? Quels sont les faux ? Où peut-on les voir ? Quelle est leur origine, leur histoire ? Pouvez vous m’en dire plus ?
Merci d’avance
N’oublions pas les avantages environnementaux de la construction en terre crue:
– La disponibilité locale des matériaux qui évite un transport couteux et polluant (émissions de CO2, d’oxydes d’azotes et particules cancérigènes, …).
– La fabrication du ciment et de la chaux est responsable de 5% des émissions de CO2 au niveau mondial. La terre crue est zéro-émissions si on n’ajoute pas de chaux. Avec un faible pourcentage de chaux, les émissions restent très faibles.
– Le recyclage automatique et gratuit des bâtiments non-occupés ou non-utilisés n’est pas un inconvénient, c’est un avantage. Seul les bâtiments utiles persistent que leur utilité soit d’habitation ou culturelle. Le coût de démolition et recyclage, financier et environnemental est donc lui aussi très fortement réduit.
– L’entretien n’est pas plus couteux que le ravalement des façades peintes, il consiste essentiellement à reboucher les fissures une fois par an, et se fait encore avec les matériaux locaux.
– Les murs épais en terre procurent une très forte inertie thermique permettant de niveler les écarts de température entre le jour et la nuit en procurant un confort thermique exceptionnel été comme hiver sans avoir besoin de recourir à la climatisation ou chauffage dont la fabrication de l’énergie au Maroc est très polluante.
Le confort thermique peu encore être grandement amélioré avec une isolation externe en paille ou laine de mouton qui sont aussi des matériaux locaux, ainsi que les autres techniques modernes et non polluantes appliquées pour les maisons bioclimatiques et passives.
La construction en terre n’est pas plus couteuse que la construction en béton et l’utilisation de techniques modernes respectueuses de l’environnement permettent d’obtenir des produits fini de qualité thermique bien supérieure aux constructions actuelles.
A moyen terme les économies d’énergie, et pour le Maroc une partie de son indépendance énergétique, sont des enjeux économiques majeurs.
Dans l’hôtellerie, les constructions en terre, sont très appréciées des touristes occidentaux, représentent une valeur ajoutée, et surtout une différenciation par rapport au tout-béton quasi-généralisé au Maroc.