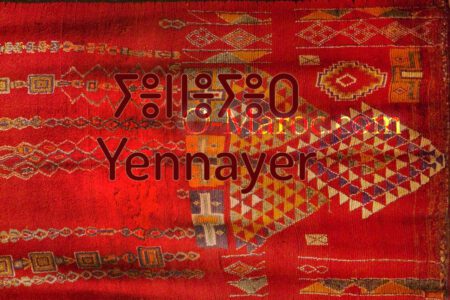Pour une fois, on ne va pas vraiment parler de Maroc sur ce site. Mais d’un autre pays, secoué par une tourmente, l’Afghanistan.
En 1974, Joseph Kessel publie le « Jeu du Roi », un reportage qui raconte le difficile tournage à la fin des années soixante d’un reportage « Les Cavaliers », tiré du roman du même nom publié en 1967. (Il ne s’agit pas du tournage du film d’Oppenheimer avec Omar Sharif en 1971).Je vous en parle aujourd’hui car la similitude entre certaines parties du Maroc et l’Afghanistan m’a frappée depuis longtemps. Et avant de crier au scandale ou de m’accuser de yoyoter, d’autres que moi l’ont déjà notée. Le grand écrivain Tahir Shah, l’auteur de La Maison du Calife, est lui-même d’origine afghane. Élevé à Londres, il raconte dans un de ses livres que son père allait soigner son mal du pays au Maroc.

La similitude entre certains moments de l’histoire du Maroc et de l’histoire de l’Afghanistan est aussi très forte. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent que les deux pays ont évolué différemment, à commencer par la mer et l’ouverture au monde Méditerranéen, mais, quelque part, à quelques décennies de distance, beaucoup de situations ont eu des similitudes importantes.
Il y a beaucoup de montagnes au Maroc, il n’y a pas de plaines en Afghanistan
Ni de côtes maritimes, l’Afghanistan est enclavé dans les terres.
La montagne est une « culture » à elle seule.
Des peuples éloignés les uns des autres, mais montagnards, sont souvent plus proches dans leur mode de vie que de leurs concitoyens des plaines et des grandes villes. Les paysages variés du Maroc, son ouverture sur la mer, sur le monde, font que, globalement, ce pays n’est pas comparable à l’Afghanistan.
Mais… dans les parties montagneuses du Maroc, c’est un peu différent.

Je me souviens d’un passage tardif du col du Tichka, je regardais les petits restaurants alignés de part et d’autre de la route goudronnée et relativement étroite, le reste du village éloigné en hauteur, les voitures qui s’arrêtaient, les bus qui lâchaient leurs passager pour une pause avant de continuer le voyage vers Ouarzazate ou Casablanca, les visages des hommes, souvent marqués par les conditions hostiles, coiffés de chèches, autour d’une petite théière et, éventuellement, d’un tajine de viande grillée, et de me retrouver transportée, d’un seul coup, dans « Les Cavaliers », dans la passe du Chibar dont la description ouvre le roman :

Les camions n’avançaient guère plus vite que les chameaux des caravanes et l’homme à cheval que le piéton. L’état de la chaussée les obligeait au même pas : on arrivait aux approches du Chibar, seule trouée dans le massif auguste et monstrueux de l’Hindou Kouch, par où, à 3 500 mètres d’altitude, se faisait tout le trafic et tout le charroi entre l’Afghanistan du Sud et l’Afghanistan du Nord.
D’un côté, la falaise en dents de scie. De l’autre, un vide sans fond. Des ornières énormes, des quartiers de roc éboulé coupaient la voie. Les côtes, les lacets, les tournants devenaient toujours plus raides, plus difficiles et dangereux à négocier.
Pour les caravaniers, les muletiers, les bergers et leurs bêtes, la fatigue, certes, était grande à cause du froid intense et de l’air raréfié. Du moins, collés comme des files de fourmis contre la paroi de la montagne, cheminaient-ils sans risque.
Pas les camions. La route, souvent, était si mince qu’ils en occupaient toute la surface et que leurs roues, alors, le long de l’abîme, mordaient sur le bord ébréché, croulant. Une maladresse, une distraction du conducteur, une défaillance du moteur ou des freins menaçait de précipiter dans le gouffre les véhicules mal entretenus, décrépits avant l’âge. Leur fret, qui dépassait toujours et de beaucoup les normes permises, les rendait encore moins maniables sur les pentes abruptes.
[…]En cet endroit prédestiné, faisaient étape tous les convois qui assuraient les échanges entre les deux moitiés de l’Afghanistan, que séparait l’Hindou Kouch. Il y avait toujours là des dizaines de véhicules à l’arrêt, dans chaque sens. Ceux qui venaient du sud étaient rangés le long du torrent, les autres, contre le roc.
Sur les deux côtés de la plate-forme s’étirait une très longue file d’auberges rudimentaires. Parce que l’on y consommait principalement du thé, noir ou vert, elles portaient le nom de tchaïkhanas. Les bâtisses en torchis ne contenaient, à l’intérieur, qu’une pièce obscure. Dehors, il y avait une terrasse sous auvent. C’était là que se rassemblaient les voyageurs. Le froid y était plus vif et la bise plus cruelle. Mais quel homme dans son bon sens eût voulu, pour si peu, renoncer à un spectacle comme celui que donnaient l’arrivée des camions, le débarquement des passagers, les retrouvailles des amis qui voyageaient en sens inverse.
Certes, la route de Tichka est plus large et en meilleur état. Certes, les camions qui la traversent ne sont pas surchargés de passagers sur le toit (mais peuvent en emmener quelques uns…). Certes, beaucoup des véhicules sont plus luxueux [merci le tourisme]. Pour le reste, c’est la même chose.

Cette galerie rapproche des photos de l’Afghanistan et du Maroc. Il est très facile de savoir où on est en faisant attention à quelques détails, mais reconnaissez que « globalement » ça se ressemble !
La « modernisation » n’est pas toujours « l’Occidentalisation »
Il est facile, au Maroc comme ailleurs, de se laisser duper par des vêtements occidentaux, des voitures et du Coca-Cola. Il est dangereux d’imaginer, comme l’ont explicitement fait les Américains en Afghanistan et en Irak, entre autres, il est dangereux, donc, d’imaginer qu’un homme en costume cravate qui boit du Coca devient automatiquement un capitaliste libéral convaincu. L’Afghanistan du début du XX° siècle était modernisé par rapport à celui du XV°, le Japon s’est modernisé tout en gardant une identité forte, etc.
Mais l’Afghanistan de la fin du XX° siècle n’était certainement pas « occidentalisé » et les quelques photos qui circulent sur le net de femmes se baladant en jupes courtes dans le Kaboul des années 70-80 ne doivent pas être prises pour autre chose que ce qu’elles sont : la représentation d’une minorité extrêmement faible et peu représentative mise en avant par un pouvoir communiste qui a eu besoin, dès le début de sa révolution, d’un soutien de l’étranger et qui n’a pas été accepté et soutenu majoritairement dans le pays.


On voit passer régulièrement le même type d’images sur les forums marocains, de femmes en habits européens dans le Casablanca des années soixante, assortis de commentaires nostalgiques d’un « bon temps » où les femmes ne mettaient pas ces « horribles habits musulmans qui nous sont imposés de l’étranger », avec la même mauvaise foi : ces photos montrent une minorité de femmes, soit des colons, soit des marocaines juives, soit enfin des marocaines de la haute société. Mais à la même époque, la marocaine « de base » était voilée.
Et surtout, en djellaba ou en caftan, en jeans ou en costume, voilées ou pas, barbus ou imberbes, les marocain-e-s pensent avec une majorité écrasante que la femme devrait arriver vierge au mariage, même s’ils reconnaissent maintenant que les relations sexuelles hors mariage sont une affaire privée et qu’ils connaissent beaucoup de gens qui les pratiquent. Ou, dans un autre registre, une très faible partie de la population soutient les « dé-jeuneurs » (ceux qui veulent pouvoir manger en public pendant Ramadan).
Ce que nous disent ces photos
Si on regarde bien ces quelques photos qui tournent en boucle, on remarque plusieurs choses :
- A une exception près, ce sont des femmes entre elles
- « Autour » ce n’est pas occidental, sur certaines images on voit juste à côté des femmes en tchador, des hommes en habit traditionnel
- On manque totalement de contexte
Or ce contexte est essentiel pour comprendre ce qui est montré et, par conséquent, à quel point ces images ne peuvent pas prouver une réelle occidentalisation de l’Afghanistan qui serait détruite par les vilains Talibans.

Ces photos montrent ce que des étrangers qui, pour la plupart n’ont jamais mis les pieds en Afghanistan, ou pas depuis longtemps, veulent voir de ce pays.
L’histoire Afghane moderne
Pour tenter de comprendre un peu l’Afghanistan, il faut d’abord comprendre les tribus. Comme au Maroc. Bien plus que le Maroc, l’Afghanistan est un pays où toute la vie politique est organisée en fonction de l’appartenance tribale. Et en fonction d’une tribu en particulier, les Pachtounes, qui sont partagés pour moitié entre l’Afghanistan et le Pakistan (et c’est pour cela qu’il y avait tellement de réfugiés Afghans au Pakistan). L’instabilité politique du XX° siècle est avant tout liée aux révoltes tribales.
C’est peut-être la situation qu’aurait connu le Maroc si la lutte contre la colonisation n’avait pas fait naître un esprit national, une conscience marocaine qui transcendait les divisions voulues par les Français entre Arabes et Berbères. Cette cohésion nationale a été renforcée encore par la Marche Verte. Donc le Maroc est un pays où l’appartenance « tribale » est encore importante, même si elle se dissimule souvent derrière les liens familiaux, mais elle n’est pas clivante (et ça, on le doit aussi en partie à l’intelligence de la politique de Mohammed VI et de l’intégration de l’amazigh).
Comme l’Iran, avec les mêmes résultats, l’Afghanistan a vécu une occidentalisation forcée

C’est le deuxième point très important de cette histoire. Ces femmes dévoilées le sont à cause de diktats politiques, par parce que l’ensemble de la population était d’accord. N’est pas Atatürk qui veut (et la Turquie contemporaine s’est bien réislamisée).
Mohammad Zaher Shah, le dernier roi Afghan, a régné de 1933 à 1973, mais une bonne partie de son règle a été dominée par ses oncles (un peu comme Moulay Abdelaziz, qui a eu de sacrés problèmes avec ses frères Abdelhafid et Youssef, un peu comme c’était prévu pour le futur Mohammed V, choisi pour sa personnalité plutôt effacée, et qui s’est révélé un grand roi, unissant tout le Maroc derrière lui grâce à l’exil à Madagascar imposé par les Français).
Zaher Shah est pachtoune, à l’inverse de Mohammed V, il ne saura pas unir son pays au-dessus des fractions tribales. En 1945-46, les Hazaras (qui s’en prendront plein la poire sous les Talibans), se révoltent contre la pachtounisation des moeurs du pays. Le fait que les Hazaras soient une minorité chiite ne les a pas aidés du tout. Et comme le père de Zaher Shah avait été assassiné par un Hazara… Zaher Shah est pachtoune comme Massoud, comme Massoud il est passé par le lycée Français de Kaboul et a fait de longues études à l’étranger.
Bref. Zaher Shah a réellement été au pouvoir pendant dix ans, de 1963 à 1973. Le pays est alors confronté à une grave crise économique, d’un côté ça se passe maintenant très mal avec les voisins pakistanais, la principale frontière commerciale est fermée, d’un autre côté, il y a la sécheresse et donc l’Afghan « de base » pas tout à fait ouvert aux talons hauts crève la dalle.
Zaher Shah va faire ce qu’il peut, « mais peut peu », comme on dit sur les bulletins scolaires.
Il tente donc de faire appel aux puissances étrangères (USA et surtout URSS, déjà) pour obtenir des aides économiques et des investissements, de libéraliser-moderniser son pays.
Côté droits des femmes, on y va « chouïa chouïa », il encourage l’instruction des filles, il lève l’interdiction de sortir sans le voile.
Sa femme, Humaïra Begum, apparait sans voile, en vêtements occidentaux. Cela suscite les réactions offusquées des traditionalistes. Tout comme il y a quelques années, les Qatari s’offusquaient des apparitions « sans voile » ou « avec un simple turban qui laisse voir les cheveux » de Sheika Moza bint Nasser al-Missned, la femme du précédent émir. Et comme la réputation de Moulay Abdelaziz fut sapée par ses pratiques « occidentales », à commencer par la photographie.
La première photo, celle des trois jeunes filles en mini-jupe, a été prise dans un quartier huppé de Kaboul (genre Anfa ou le triangle d’Or), en 1972. Laurence Brun, la photographe qui l’a faite raconte
En 1973, coup d’état pacifique. Surtout grâce à Zaher Shah qui décide de laisser tomber l’affaire.
Mohammad Daoud Khan, un cousin du roi (une sorte de Moulay Hicham ?) proclame la République et s’éloigne des Russes.
Ce grand libéral fait passer une constitution qui reconnaît un parti unique et se rapproche des États-Unis. Ça ne gêne absolument pas ces derniers de supporter un régime vaguement dictatorial… Mais il « peut peu » encore plus moins que Zaher Shah, la crise économique ne s’arrange pas du tout. Par contre il continue la politique de scolarisation et d’éducation des filles.
En 1978, un coup d’état communiste le chasse du pouvoir. L’URSS n’est pas ravie, mais finit par accepter de soutenir le pays. L’Afghanistan va alors rentrer dans un mode de coopération réservé aux « pays frères » : réformes et surveillance. A côté de réformes agraires et collectivistes, de la suppression des dettes paysannes, sont mises en place :
- une école obligatoire pour les filles
- des mesures favorables aux droits des femmes, qui chatouillent les patriarcats établis dans les villages
- à nouveau, le droit de ne pas porter le voile
- le droit de conduire seules
- une main-mise sur l’éducation supérieure et sur les grandes sociétés, avec des « coopérants » imposés dans les équipes, qui sont là autant pour aider que pour être l’oeil de Moscou. Donc oui, il y avait 60% des enseignants de l’université de Kaboul qui étaient des femmes, mais c’était une université « occupée ».

Toutes les autres photos des femmes afghanes « occidentales » datent de cette époque.
Est-ce que la société était globalement d’accord ? Certainement pas, sinon la résistance islamiste n’aurait pas été si violente.
Et comme la société traditionnelle n’était pas en phase avec ces réformes, on a constaté, même sous les communistes, une augmentation des attentats contre les femmes en vêtements occidentaux et un harcèlement des femmes qui travaillaient.
Tout ce qu’on oublie de dire quand on montre ces photos de propagande communistes de femmes en tailleur et souriantes….
La vidéo du Monde sur la réalité derrière la photo des Afghanes libérées
Je vous engage donc, finalement, à regarder cette vidéo remarquable du Monde. Le journal a retrouvé l’auteure de la photo des mini-jupes, qui est encore aujourd’hui désolée de l’interprétation qui en a été faite, et que cette photo ait été montrée à Trump pour le persuader qu’il suffisait d’une présence américaine pour que l’Afghanistan s’occidentalise.
Je ne prétends pas connaître l’Afghanistan parce que je connais – un peu – le Maroc et que j’ai pu connaître un Maroc traditionnel qu’on peut perdre de vue quand on vit et travaille à Casablanca.
Je ne prétends pas non plus que l’Afghanistan et le Maroc soient semblables.
Mais ce que je connais du Maroc me permet de dire que la présentation d’un Afghanistan idyllique où les femmes de promenaient librement en vêtements occidentaux est une foutaise.
Ce que je connais du Maroc me permet de dire que l’habit ne fait pas le moine, que oui, beaucoup d’Afghanes ont des habits traditionnels plus colorés et moins occultants que la burqua, mais qu’elles sont très certainement soumises aux mêmes « oppressions » liées à la tradition.
Ce que je connais du Maroc et d’autres pays me fait dire que l’Occident ferait mieux d’arrêter de croire à l’universalisme de sa civilisation, et qu’il devrait comprendre qu’il y a plusieurs voies vers la modernité, que la libération de la femme passe d’abord et avant tout par l’éducation et donc la prospérité économique.
Ce qui se passe aujourd’hui en Afghanistan est désolant et terrible. On en serait sans doute pas arrivé là sans une succession ininterrompue d’interventions occidentales depuis plus de soixante ans, interventions qui se partagent entre le cynisme le plus total et une sorte d’angélisme imbécile, ce que j’appellerais la « civilisation par le Coca ».
Et si vous voulez en savoir plus sur l’Afghanistan, vous pouvez vous abonner au compte Facebook de Tahir Shah qui publie régulièrement des souvenirs de ses différents voyages en Afghanistan. Ou regarder aussi cette autre vidéo
En savoir plus
 Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !
Une coquille ou une erreur de syntaxe ? Vous pouvez sélectionner le texte et appuyer sur Ctrl+Enter pour nous envoyer un message. Nous vous en remercions ! Si ce billet vous a intéressé, vous pouvez peut-être aussi laisser un commentaire. Nous sommes ravis d'échanger avec vous !